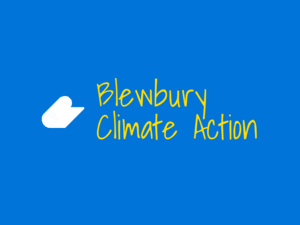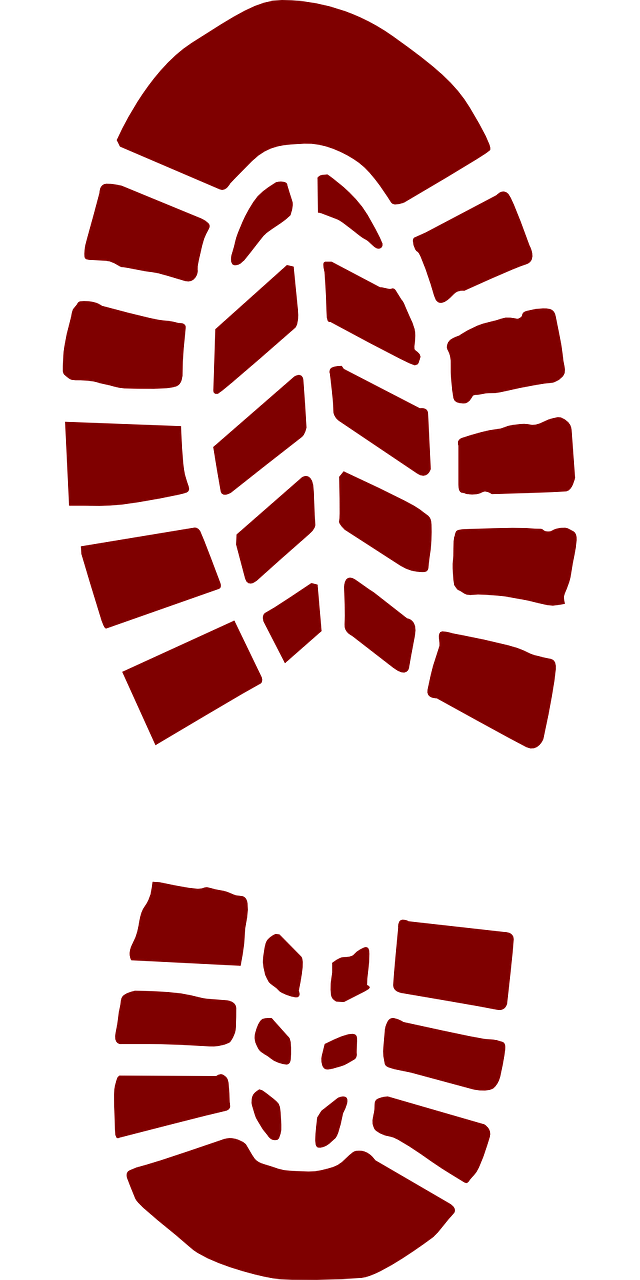|
EN BREF
|
L’essor des services numériques entraîne une augmentation significative de la consommation d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre à l’échelle mondiale. Entre 2013 et 2017, la consommation énergétique du secteur a crû de 50%, représentant désormais une part importante de la consommation mondiale d’électricité. Les data centers, essentiels pour le stockage et le traitement des données, requièrent une électricité considérable et leur fabrication impacte gravement l’environnement.
Les géants du cloud, tels qu’Amazon, Microsoft et Google, affichent des objectifs ambitieux de neutralité carbone, mais leur stratégie pose des questions sur réellement leur engagement environnemental. Plusieurs d’entre eux se basent sur des achats de crédits carbone pour compenser leurs émissions, tandis que l’atteinte de la neutralité carbone est souvent perçue comme illusoire si l’on considère l’échelle globale des enjeux climatiques.
Quand bien même ces entreprises mettent en avant des efforts pour augmenter l’utilisation des énergies renouvelables pour leurs opérations, leur impact global reste préoccupant. Leurs engagements en matière de réduction des émissions ne semblent pas suffisants au regard des défis climatiques contemporains, soulevant des interrogations sur leur véritable rôle dans la lutte contre le changement climatique.
Dans un monde où le numérique est omniprésent, la question de l’impact écologique des géants du cloud, à savoir Amazon, Microsoft et Google, se pose avec une acuité croissante. Ces entreprises, nommées hyperscalers, ont développé des infrastructures massives pour le stockage et le traitement des données, entraînant un besoin énergétique colossal. Cet article vise à examiner les répercussions environnementales de leurs activités, notamment en matière d’émissions de gaz à effet de serre, tout en s’interrogeant sur la pertinence de leur communication en matière de durabilité.
Une consommation énergétique exponentielle
L’usage croissant des services numériques, notamment via le cloud, influe considérablement sur la consommation énergétique globale et les émissions de gaz à effet de serre (GES). En effet, entre 2013 et 2017, le secteur a enregistré une augmentation de 50 % de sa consommation énergétique, représentant aujourd’hui entre 6 % et 10 % de la consommation mondiale d’électricité. Cela soulève une question cruciale : les entreprises comme Amazon, Microsoft et Google sont-elles réellement conscientes de l’impact écologique de leurs infrastructures ?
Les data centers, essentiels à la chaîne de valeur numérique, se multiplient rapidement et nécessitent une immence quantité d’électricité pour fonctionner. La fabrication de ces serveurs requiert également une exploitation intensive de matières premières, engendrant des impacts environnementaux significatifs.
Les nuances du cloud computing
À la différence des solutions on-premise, où les serveurs sont détenus par les utilisateurs, le cloud permet une mutualisation des ressources. Dans le cloud, les machines des différents sites d’un même opérateur sont optimisées pour exploiter pleinement leur capacité. L’utilisateur paie alors à l’usage, une flexibilité qui contribue à l’engouement pour ces services, laissant croire qu’ils sont moins gourmands en ressources. Mais cette vision doit être remise en question.
Une empreinte carbone floue
Avec le développement du cloud, il est impératif de comprendre si les fournisseurs de ces services maîtrisent réellement leur empreinte carbone. Amazon Web Services (AWS), Azure (Microsoft) et Google Cloud se vantent d’initiatives en faveur d’une neutralité carbone, allant jusqu’à revendiquer des objectifs de zéro émission nette à divers échéanciers. Pourtant, ces promesses sont souvent accompagnées de zones d’ombre quant à leur mise en œuvre.
Les objectifs de neutralité des hyperscalers
Les géants du cloud tels qu’Amazon, Microsoft et Google communiquent régulièrement sur leurs objectifs de neutralité carbone. Mais qu’en est-il réellement ?
- Google se considère neutre depuis 2007, grâce à l’achat de crédits carbone, et projette d’étendre cet objectif à l’ensemble de son empreinte d’ici 2030.
- Amazon vise à atteindre l’objectif « Net-Zero Carbon » d’ici 2040 en retirant de l’atmosphère autant de GES qu’elle en émet dans l’année.
- Microsoft, quant à lui, s’engage à être « carbone négatif », c’est-à-dire à retirer plus de carbone qu’il n’en émet.
Ces engagements, bien que louables, soulèvent des questions sur la validité des affirmations concernant la neutralité carbone. La confusion persiste entre objectifs déclarés et réalité quantifiable.
Repenser la notion de neutralité
Les termes de « neutralité », de « net zero » et de « carbone négatif», bien que séduisants, peuvent induire une perception erronée selon laquelle les entreprises effacent leur empreinte carbone. En réalité, la neutralité carbone ne peut être évaluée qu’à l’échelle planétaire. À l’échelle d’une entreprise, ces calculs sont souvent trompeurs.
Les entreprises doivent comprendre que la véritable action climatique requiert une vision d’ensemble. Elles ne peuvent simplement se soustraire à leurs responsabilités en achetant des crédits carbone ou en finançant des projets sans un plan d’action concret pour réduire leurs propres émissions.
Réduire les émissions : un enjeu majeur
Pour atteindre des objectifs de neutralité, il est crucial que les entreprises réduisent d’abord leurs propres émissions directes et indirectes. Cependant, des études montrent que les efforts réalisés par Google, Amazon et Microsoft ne conduisent pas à la diminution de leurs émissions en valeur absolue.
Actuellement, leurs stratégies de réduction reposent principalement sur l’utilisation d’énergies renouvelables, mais ces actions ne suffisent pas à garantir une diminution réelle et mesurable de leur impact environnemental. Les entreprises doivent adopter des plans d’actions ambitieux.
Électricité : un enjeu central
L’électricité est un facteur critique pour la consommation des grandes entreprises du cloud. Ces entreprises investissent massivement dans des énergies renouvelables pour alimenter leurs centres de données. Trois méthodes récurrentes sont utilisées :
- Achat de Garanties d’Origine EnR via un système de marché.
- Financement de capacités EnR additionnelles via des contrats de longue durée (Power Purchase Agreement – PPA).
- Constitution de leur propre parc de production EnR.
Toutefois, les entreprises peuvent faire face à des incohérences entre leur consommation d’électricité et les énergies qui alimentent réellement leurs infrastructures.
Le défi de l’efficacité énergétique
Malgré des efforts en matière d’énergies renouvelables, les entreprises du cloud doivent prioriser l’efficacité énergétique. En effet, une simple transition vers des sources d’énergie renouvelables sans prise en compte de la réduction de la consommation d’énergie ne suffira pas.
Les entreprises devraient se concentrer sur des actions concrètes, telles que l’optimisation desdonnées technologiques et l’amélioration des processus existants, pour réduire leur empreinte énergétique.
La complexité des impacts environnementaux
En plus de l’électricité, les impacts écologiques des services cloud comprennent la fabrication et le fonctionnement des équipements nécessaires. Peu d’acteurs du cloud divulguent des chiffres sur ces autres postes, entravant ainsi une réflexion globale sur leur impact.
Il est essentiel de réfléchir à des actions telles que l’allongement de la durée de vie des serveurs ou le reconditionnement plutôt qu’à une simple mise en avant de projets environnementaux externes.
La promesse d’une meilleure performance carbone
Les fournisseurs du cloud affirment que leur modèle de mutualisation des ressources est intrinsèquement plus performant sur le plan carbone que les solutions traditionnelles. Cependant, ces assertions sont sujettes à évaluation.
- La mutualisation des machines n’entraîne pas nécessairement un meilleur contrôle des ressources et peut induire un effet rebond en raison d’une surconsommation.
- La redondance dans le cloud peut être plus importante que dans les installations traditionnelles, ce qui peut conduire à une surconsommation d’énergie.
Les entreprises doivent remettre en question ces affirmations et vérifier que le passage au cloud ne se fait pas aux dépens de l’environnement.
Des outils de mesure comme levier d’action
Pour répondre aux attentes de leurs clients, les fournisseurs de cloud offrent des outils permettant de mesurer l’empreinte carbone des services utilisés. Cependant, ce reporting est parfois partiel et peu pertinent.
Les périmètres et méthodologies de calcul divergent fortement d’un acteur à l’autre, et il est essentiel que les entreprises clarifient ces éléments afin de renforcer leur crédibilité dans le suivi de leur impact écologique.
Un nouveau modèle économique à envisager
Pour dépasser les stratégies de communication, ces entreprises pourraient explorer de nouveaux modèles économiques qui n’incitent pas à la surconsommation des ressources. En d’autres termes, la sobriété énergétique doit devenir un axe central de leur stratégie globale.
La responsabilité ne repose pas uniquement sur les fournisseurs de cloud ; leurs clients doivent également veiller à diminuer leur empreinte carbone numérique de manière efficace.
Vers une prise de conscience collective
La réussite d’une transition vers un cloud plus durable dépend d’une prise de conscience collective des acteurs du numérique et de leurs clients. Les acteurs tels que Google, Amazon et Microsoft ont un rôle crucial à jouer dans ce processus.
En fin de compte, si les engagements affichés par ces fournisseurs ont le potentiel de contribuer à un avenir durable, il est crucial de veiller à ce qu’ils se traduisent par des actions mesurables et des réductions réelles des émissions de carbone. La transparence, l’engagement et l’innovation sont essentiels pour construire un avenir où le cloud peut véritablement être synonyme de durabilité.

De nos jours, la montée en puissance des services cloud a eu des répercussions notables sur la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre à l’échelle mondiale. Entre 2013 et 2017, ce secteur a vu sa consommation énergétique augmenter de 50 %, contribuant ainsi à représenter entre 6 % et 10 % de la consommation mondiale d’électricité, principalement à partir de sources très intensives en carbone.
Les data centers, en tant que maillons clé de cette chaîne, se développent de manière exponentielle. Ils génèrent une demande énergétique considérable, non seulement pour leur fonctionnement, mais aussi pour le refroidissement de leurs serveurs. Cette consommation massivement énergétique soulève des questions cruciale quant à l’engagement écologique des géants du cloud comme Amazon, Microsoft et Google.
Sur le plan de la communication, les stratégies affichées par ces entreprises soulèvent des interrogations. Par exemple, Google se présente comme neutre en carbone depuis 2007, grâce à des achats de crédits carbone. Cette stratégie semble rassurante, mais pose la question de la validité de telles affirmations. L’illusion de la neutralité en termes d’empreinte carbone reste à vérifier, car les conséquences écologiques de leur consommation d’énergie peuvent ne pas être intégrées dans une vue d’ensemble.
Quant à Amazon, son engagement à atteindre l’objectif de « Net-Zero Carbon » d’ici 2040 est louable, mais il reste à savoir comment cet objectif sera matérialisé. L’achat de crédits carbone ne devrait pas remplacer les efforts de réduction des émissions directes. De même, la promesse de Microsoft de devenir « carbone négative » pose des questions. Quels moyens seront mis en œuvre pour réussir à absorber davantage de carbone que l’entreprise n’en émet ?
Les données scientifiques à l’appui des affirmations de neutralité s’avèrent complexes. En effet, la définition de la neutralité carbone est largement débattue, et la réalité est que, à l’échelle d’une entreprise, elle peut sembler inapplicable. Les actions de ces géants doivent s’inscrire dans un cadre structuré, où le développement de puits de carbone ne sera qu’une partie de la solution. La déclaration d’engagements ne suffira pas si elle n’est pas suivie d’actions concrètes et mesurables.
Pour l’instant, les efforts déployés par ces entreprises n’ont pas encore prouvé une réduction nette de leurs émissions en valeur absolue. Les soutiens envers les énergies renouvelables sont valorisés et utilisés comme arguments principaux, mais cela ne doit pas faire oublier le besoin vital de reduire la consommation, tant d’énergie que de matières premières. Au lieu de se reposer sur des stratégies de communication séduisantes, ces entreprises ont l’obligation de s’engager dans une réduction significative de leur impact environnemental.
Cela constitue un appel pour un changement de paradigme dans leur mode d’exploitation : abandonner le simple marketing vert pour mettre en œuvre des mécanismes efficaces discipline de réduction, de sobriété et d’efficacité énergétique. Le cloud, malgré ses avantages, doit également passer la barre de son empreinte écologique et de ses performances qui pourraient masquer des realités plus troublantes.